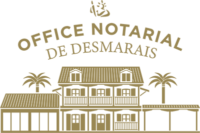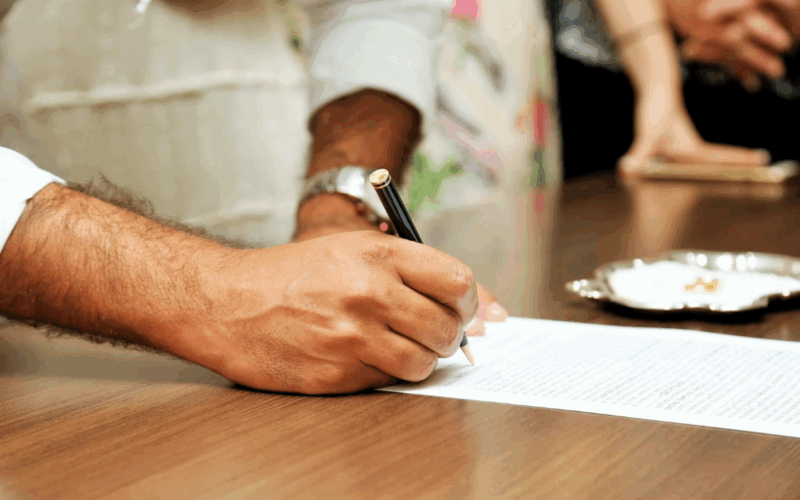Transmettre de son vivant, c’est bien plus qu’une opération juridique : c’est un geste d’amour, une manière d’anticiper et d’éviter les conflits du lendemain.
Pourtant, la donation reste un terrain délicat, où la générosité doit composer avec la loi et la fiscalité.
En 2025, les règles n’ont pas fondamentalement changé : chaque parent peut offrir à chaque enfant jusqu’à 100 000 euros tous les quinze ans, sans que l’État n’en réclame une part. À cela s’ajoutent des possibilités particulières, comme le don de somme d’argent exonéré jusqu’à 31 865 euros, à condition que le parent ait moins de 80 ans et l’enfant plus de 18 ans. Ce cadre fiscal, en apparence généreux, peut pourtant se transformer en piège si l’on ne mesure pas ses conséquences à long terme.
Car donner, c’est aussi parfois fragiliser son propre avenir, ou bouleverser l’équilibre entre frères et sœurs. Une donation simple peut susciter, des années plus tard, une rancœur inattendue. La donation-partage, elle, permet de clarifier les choses et d’apaiser les tensions futures, en fixant aujourd’hui ce qui sera demain. D’autres dispositifs, plus subtils encore – donations graduelles ou résiduelles – permettent de transmettre en deux temps : d’abord à un conjoint, puis aux enfants, comme pour inscrire la mémoire dans la continuité.
Dans ce labyrinthe où se croisent amour, patrimoine et règles strictes, le rôle du notaire devient essentiel. C’est lui qui traduit les intentions en actes, qui protège les bénéficiaires tout en veillant à l’équité. Anticiper une transmission, ce n’est pas seulement optimiser une fiscalité, c’est surtout écrire une histoire familiale sans laisser place à l’amertume.